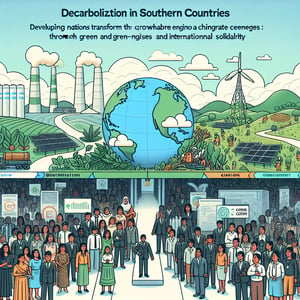
Décarbonation dans les pays du Sud : enjeux et voies d'avenir
Décarbonation des pays en développement en 2025 : l'urgence climatique comme levier de croissance durable
À l'horizon 2025, la **décarbonation** n'est plus une option mais un impératif stratégique, particulièrement pour les pays en développement. Pris en étau entre des responsabilités historiques faibles en matière d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et une vulnérabilité extrême aux conséquences du **changement climatique**, ces nations se trouvent à un carrefour décisif. Les manifestations de la crise climatique — tempêtes plus violentes, sécheresses prolongées, inondations dévastatrices et une montée inexorable des eaux — exacerbent des fragilités économiques et sociales préexistantes. Pourtant, loin d'être une simple contrainte, cette transition vers une **économie bas-carbone** représente une opportunité historique. À travers l'adoption massive des **énergies renouvelables**, l'intégration de technologies propres et l'élaboration de politiques publiques visionnaires, ces pays peuvent tracer une nouvelle voie vers une croissance plus résiliente, inclusive et durable. Cet article explore en profondeur les défis colossaux, les leviers d'action concrets et les stratégies gagnantes de ce virage indispensable pour l'avenir de la planète.
- Vulnérabilité et Injustice Climatique : Les pays en développement, les moins responsables du réchauffement global, sont en première ligne face à ses impacts les plus destructeurs, menaçant leur sécurité alimentaire, leur santé publique et leur stabilité économique.
- Opportunité de Transformation : La décarbonation est un puissant moteur de **développement durable**, capable de créer des emplois verts, de garantir la souveraineté énergétique et de stimuler l'innovation locale pour une relance économique verte.
- Catalyseurs Indispensables : Le succès de cette transition repose sur trois piliers : un soutien international accru via la **finance climatique**, un transfert de technologie équitable et un renforcement des capacités locales pour piloter les projets.

Partie 1 : Le changement climatique : une pression directe et disproportionnée sur les pays du Sud
Les pays en développement, souvent qualifiés de "pays du Sud global", subissent de plein fouet les assauts d'un dérèglement climatique qu'ils n'ont que marginalement provoqué. Leur géographie (zones côtières de faible altitude, régions arides ou semi-arides) et la structure de leur économie, fortement dépendante des ressources naturelles comme l'agriculture, la pêche et la foresterie, les rendent particulièrement vulnérables. Les effets sont systémiques et en cascade : la raréfaction des ressources en eau potable met en péril des millions de vies, la dégradation des sols et la perte de biodiversité menacent la **sécurité alimentaire**, et les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes engendrent des crises sanitaires et des déplacements massifs de population. Le chiffre de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) pour 2024 est sans appel : près de 90 % des **réfugiés climatiques** proviennent de pays à revenu faible ou intermédiaire. C'est le paradoxe de l'injustice climatique : ceux qui ont le moins contribué au problème sont ceux qui en paient le prix le plus fort.

Les exemples concrets abondent et illustrent l'urgence de l'**adaptation climatique** et de la **résilience**. Au Bangladesh, nation deltaïque par excellence, les inondations chroniques et la salinisation des terres agricoles coûtent, selon la Banque mondiale, jusqu'à 2 % du PIB annuel, anéantissant les efforts de développement. En Afrique de l’Ouest, la désertification progresse et les vagues de chaleur extrêmes menacent les rendements agricoles de plus de 200 millions de petits agriculteurs qui dépendent de cultures pluviales. La santé publique est également une victime directe : la hausse des températures étend les zones de transmission de maladies vectorielles comme le paludisme et la dengue, tandis que la contamination des sources d'eau après les inondations provoque des épidémies de choléra et autres maladies hydriques. Face à cette menace existentielle, l'intégration de la **décarbonation** dans les politiques publiques n'est plus un choix, mais une stratégie de survie, malgré des ressources financières et techniques souvent très limitées.
Partie 2 : La décarbonation, un puissant vecteur de développement durable et inclusif
Réduire la décarbonation à une simple question de diminution des émissions de CO2 serait une erreur fondamentale. Pour les pays en développement, elle représente un levier de transformation sociétale sans précédent. Investir massivement dans le **solaire photovoltaïque**, l'**éolien** (terrestre et offshore), la **biomasse** issue de déchets agricoles ou encore les **micro-réseaux électriques** intelligents ouvre des perspectives de développement économique et social radicalement nouvelles. Ces solutions décentralisées sont particulièrement adaptées pour électrifier les zones rurales, souvent délaissées par les réseaux centralisés traditionnels. En 2024, des pays comme le Pérou (avec ses projets hydroélectriques au fil de l'eau), le Kenya (leader de la géothermie) ou l'Indonésie (qui mise sur le solaire et la biomasse) accélèrent leur **transition énergétique**, attirant des capitaux internationaux et favorisant l'émergence d'un écosystème d'entreprises vertes innovantes.

Le potentiel de co-bénéfices est immense. Sur le plan économique, la transition énergétique est une machine à créer des **emplois verts** locaux, non délocalisables, dans l'installation, la maintenance, la fabrication de composants et la gestion de réseaux. Elle stimule les économies rurales en permettant le développement d'activités artisanales et agricoles modernisées. L'électrification des écoles améliore l'éducation, tandis que celle des centres de santé permet de conserver les vaccins et d'utiliser des équipements médicaux vitaux. Sur le plan stratégique, cette transition renforce la **souveraineté énergétique** en réduisant la dépendance coûteuse et volatile aux importations de combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz). Enfin, couplées à la révolution numérique, les technologies vertes ouvrent des champs d'innovation dans l'**agritech** (agriculture de précision moins gourmande en eau), l'**e-mobilité** (transports publics propres) ou la construction de **bâtiments durables** à haute efficacité énergétique.
Partie 3 : Les obstacles structurels et le besoin criant d'un accompagnement international massif
Malgré cet immense potentiel, la route vers une économie bas-carbone est semée d'embûches. L'obstacle le plus important reste le **financement climatique**. Le coût initial des infrastructures vertes (centrales solaires, parcs éoliens, modernisation des réseaux) est colossal et dépasse souvent la capacité d'investissement des gouvernements, lourdement endettés, ou des entreprises locales. Les infrastructures existantes, conçues pour un modèle centralisé basé sur les énergies fossiles, sont souvent vétustes et inadaptées à l'intermittence des renouvelables, ce qui freine la décentralisation énergétique. À ces défis techniques s'ajoutent des freins politiques et de gouvernance : instabilité politique, corruption, cadres réglementaires flous ou encore des priorités socio-économiques perçues comme plus urgentes (logement, santé, accès à l’eau potable), qui relèguent l'action climatique au second plan.

Le déficit en **capacités humaines et techniques** est un autre frein majeur. La transition énergétique exige des compétences pointues qui font souvent défaut. Former une nouvelle génération d'ingénieurs en énergies renouvelables, de techniciens de maintenance, de planificateurs territoriaux et d'experts en finance verte prend du temps et des ressources considérables. De plus, l'accès aux financements internationaux, bien que généreux sur le papier, est souvent un parcours du combattant. Les procédures de demande de fonds auprès d'organismes comme le **Fonds Vert pour le Climat (GCF)** sont complexes, bureaucratiques et exigent une expertise que de nombreux pays ne possèdent pas en interne. Un rapport du Fonds Vert Climat a révélé que seuls 30 % des projets approuvés en 2023 étaient directement portés par des entités nationales des pays en développement, les autres étant pilotés par des agences multilatérales ou des intermédiaires étrangers, ce qui limite l'appropriation locale des projets.
Partie 4 : Les mécanismes internationaux de soutien à la transition bas-carbone : un écosystème à renforcer

Face à l'urgence, l'architecture de la finance climatique internationale se complexifie et se renforce, même si elle reste insuffisante. Le **Fonds Vert pour le Climat (GCF)** est l'instrument phare de l'**Accord de Paris**, visant à mobiliser des fonds pour des projets d'atténuation et d'adaptation. D'autres acteurs majeurs comme le **Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)**, les banques multilatérales de développement (Banque mondiale, Banque Africaine de Développement) ou encore des facilités régionales comme celle de l'Union européenne pour l'Afrique, mobilisent des dizaines de milliards d'euros. Une avancée notable de la COP29 en 2024 a été l'opérationnalisation du **Fonds pour les pertes et préjudices**, destiné à aider financièrement les pays les plus vulnérables à se reconstruire après des catastrophes climatiques. Cependant, la promesse historique des pays développés de mobiliser 100 milliards de dollars par an pour l'action climatique, faite en 2009, peine encore à être pleinement tenue et honorée, creusant un déficit de confiance.
Au-delà des fonds publics, qui jouent un rôle de catalyseur, l'implication du secteur privé est cruciale pour atteindre l'échelle nécessaire. Les **partenariats public-privé (PPP)** se structurent pour dé-risquer les investissements dans les énergies propres. Des géants de l'énergie comme Siemens Gamesa, Schneider Electric ou Enel Green Power investissent de plus en plus dans des projets d'envergure en partenariat avec les États du Sud. Des instruments financiers innovants comme les **obligations vertes (green bonds)** ou les fonds d'**investissement à impact** gagnent en popularité. Des plateformes comme l' "Energy Transition Partnership for Africa" ne se contentent pas de financer des infrastructures ; elles intègrent des volets essentiels de formation professionnelle, de **transfert de technologie** et d'inclusion sociale, en veillant à ce que les femmes et les jeunes soient au cœur des nouvelles filières technologiques vertes.
Partie 5 : Stratégies gagnantes pour une décarbonation réussie et équitable
Pour que la décarbonation soit un succès, elle ne peut être une série de projets isolés. Elle doit s'inscrire dans une **stratégie nationale intégrée** et visionnaire. Cela commence par une planification sectorielle et territoriale rigoureuse, définissant des trajectoires de décarbonation claires pour l'énergie, les transports, l'industrie et l'agriculture. L'exemple du Rwanda, qui a été l'un des premiers pays africains à inscrire ses objectifs de **neutralité carbone** dans ses plans quinquennaux de développement, montre que l'anticipation politique est la clé de voûte. Le Vietnam, de son côté, a misé sur un mix énergétique audacieux, capitalisant sur son potentiel en énergies marines et solaires grâce à des partenariats technologiques stratégiques avec le Japon et la Corée du Sud.

L'implication de l'ensemble de la société est un autre facteur critique de succès. Des leviers politiques et économiques peuvent y contribuer : la mise en place de marchés carbone régionaux, une **fiscalité verte** qui pénalise les pollueurs et récompense les comportements vertueux, ou encore des offres de **microfinance** pour faciliter l'achat de kits solaires domestiques par les ménages à faibles revenus. Il est fondamental que le tissu économique local – PME, artisans, startups de la greentech – soit pleinement intégré dans la chaîne de valeur de la transition énergétique pour maximiser les retombées locales. Enfin, l'**éducation environnementale** dès le plus jeune âge et la mobilisation des médias de proximité (radios communautaires, influenceurs sur les réseaux sociaux) sont des vecteurs puissants pour ancrer la culture de la durabilité au cœur de la société.
Conclusion : La transition bas-carbone, une promesse de prospérité partagée
En conclusion, la **décarbonation des pays en développement** est bien plus qu'un impératif climatique mondial ; elle est une opportunité historique de réinventer des modèles socio-économiques pour les rendre plus résilients, plus équitables et, en fin de compte, plus prospères. Les défis sont immenses, allant du manque de financement chronique aux résistances structurelles et aux capacités techniques limitées. Néanmoins, les bénéfices à long terme — souveraineté énergétique, création d'emplois durables, amélioration de la santé publique et renforcement de la résilience climatique — sont infiniment plus grands. Le succès de cette transition ne dépendra pas uniquement des efforts de ces nations, mais d'un élan de **solidarité internationale** renforcé, incarné par un accompagnement financier et technologique juste et équitable. Le XXIe siècle sera celui de la **transition écologique** ou celui d'un dérèglement chaotique. Dans ce choix crucial pour l'humanité, les pays du Sud ne sont pas seulement des victimes potentielles ; ils sont des acteurs décisifs et les futurs leaders du développement bas-carbone.
Toutes vos questions sur la décarbonation dans les pays en développement :
Quels types de projets les pays en développement peuvent-ils mettre en œuvre pour se décarboner ?
Les projets sont variés et adaptés aux contextes locaux : grandes centrales solaires et parcs éoliens, mini-réseaux électriques décentralisés pour les villages, développement des transports publics électriques (bus, trains), construction d'infrastructures de recyclage et d'économie circulaire, promotion de l'agriculture régénératrice et de l'agroforesterie, et modernisation de l'industrie avec des processus à haute efficacité énergétique.
Quels sont les principaux bailleurs de fonds qui soutiennent ces transitions ?
Les soutiens sont multiples. On trouve les institutions multilatérales comme la Banque mondiale, le Fonds Vert pour le Climat (GCF), le PNUD, et ONU-Environnement. Il y a aussi les agences de développement bilatérales (comme l'AFD française ou la GIZ allemande), l'Union Européenne, ainsi qu'une part croissante de fonds privés, d'investisseurs à impact et de fondations philanthropiques.
Comment les citoyens et les communautés locales sont-ils intégrés dans cette transition ?
L'intégration citoyenne est essentielle pour une "transition juste". Elle se fait par la formation professionnelle aux nouveaux métiers verts, des campagnes de sensibilisation, des consultations publiques lors de la planification de projets, et des incitations financières comme des subventions pour l'achat d'équipements solaires domestiques ou des microcrédits verts à taux bonifié pour les petits entrepreneurs.
Les pays en développement doivent-ils choisir entre développement économique et action climatique ?
Non, c'est un faux dilemme. Lorsqu'elle est bien conçue, la décarbonation est un moteur de développement. Elle favorise la création d'emplois locaux, attire des investissements étrangers, réduit les dépenses liées à l'importation d'énergies fossiles, améliore la santé publique (moins de pollution de l'air) et renforce l'autonomie énergétique, créant un cercle vertueux de croissance durable.
Quel est le rôle des organisations de la société civile et des ONG locales ?
Leur rôle est fondamental et irremplaçable. Ces organisations connaissent parfaitement les besoins du terrain, possèdent la confiance des communautés et peuvent mettre en œuvre des projets avec une grande agilité. Elles jouent un rôle crucial dans le plaidoyer, le suivi des politiques publiques, la mobilisation communautaire et la garantie que la transition bénéficie réellement aux populations les plus vulnérables.
Qu'est-ce que le "transfert de technologie" et pourquoi est-il si important ?
Le transfert de technologie consiste à partager les connaissances, les compétences, les brevets et les équipements liés aux technologies propres (solaire, éolien, batteries, etc.) des pays industrialisés vers les pays en développement. Il est crucial car il permet à ces pays de "sauter" l'étape des technologies polluantes ("leapfrogging") et d'accéder directement aux solutions les plus modernes et efficaces pour leur transition énergétique, tout en renforçant leurs propres capacités d'innovation.

